 C'est l'histoire d'Emma... au début, elle a mon âge; j'ai 16 ans encore; elle a aussi mes rêves, un peu naïfs, mais elle et moi, nous souhaitons tant les réaliser! Nos petites vies seraient bien trop tristes sans ces rêves, elle qui s'ennuie au fond de son couvent, moi qui aspire à m'évader du quotidien étriqué de mes parents...
C'est l'histoire d'Emma... au début, elle a mon âge; j'ai 16 ans encore; elle a aussi mes rêves, un peu naïfs, mais elle et moi, nous souhaitons tant les réaliser! Nos petites vies seraient bien trop tristes sans ces rêves, elle qui s'ennuie au fond de son couvent, moi qui aspire à m'évader du quotidien étriqué de mes parents...
Je m'ennuie aussi au cours de français... Bien loin le collège, avec ses profs passionnés qui nous faisaient explorer la science-fiction, le fantastique, les grands romans d'amour et les grandes causes: Barjavel, Tolkien, Emily Bronte, Hemingway, Zola...
Désormais le bac approche, et comme il se prépare sur deux ans, tous les exercices que j'adorais, rédactions, suite de textes, ont disparu au lycée, au profit d'études laborieuses nourries de termes aux consonances éminemment abstraites, litotes, allégories, césures et métaphores. Pour moi, l'application de tout cet outillage mécanique aux plus beaux textes de notre littérature en évapore toute l'essence, toute la beauté, toute la poésie enfin!
Il faut dire aussi que les profs passionnés se défoncent avec les 1ère A, pas chez les scientifiques, ces espèces de tristes sires acnéiques à lunettes dont l'esprit plus porté sur les maths est forcément imperméable à toute expression un tant soit peu poétique... enfin, c'est ce que les profs de littérature s'imaginent... à ces matheux donc, les profs tristounets, qui avancent d'un ton monocorde sur un programme d'un classicisme désespérant... tant pis pour moi!
C'est ainsi que je n'ai d'autre choix que d'ingurgiter l'histoire d'Emma, de ses rêves naïfs jusqu'à son épouvantable agonie, en passant par les affres de sa recherche désespérée du bonheur romantique le plus absolu, jusque dans l'aveuglement le plus sordide...
Et c'est tout particulièrement l'étude de cet extrait qui va me frapper à vie:
Ce furent trois jours pleins, exquis, splendides, une vraie lune de miel.
Ils étaient à l’hôtel de Boulogne, sur le port. Et ils vivaient là, volets fermés, portes closes, avec des fleurs par terre et des sirops à la glace, qu’on leur apportait dès le matin.
Vers le soir, ils prenaient une barque couverte et allaient dîner dans une île.
C’était l’heure où l’on entend, au bord des chantiers, retentir le maillet des calfats contre la coque des vaisseaux. La fumée du goudron s’échappait d’entre les arbres, et l’on voyait sur la rivière de larges gouttes grasses, ondulant inégalement sous la couleur pourpre du soleil, comme des plaques de bronze florentin, qui flottaient.
Ils descendaient au milieu des barques amarrées, dont les longs câbles obliques frôlaient un peu le dessus de la barque.
Les bruits de la ville insensiblement s’éloignaient, le roulement des charrettes, le tumulte des voix, le jappement des chiens sur le pont des navires. Elle dénouait son chapeau et ils abordaient à leur île.
Ils se plaçaient dans la salle basse d’un cabaret, qui avait à sa porte des filets noirs suspendus. Ils mangeaient de la friture d’éperlans, de la crème et des cerises. Ils se couchaient sur l’herbe ; ils s’embrassaient à l’écart sous les peupliers ; et ils auraient voulu, comme deux Robinsons, vivre perpétuellement dans ce petit endroit, qui leur semblait, en leur béatitude, le plus magnifique de la terre. Ce n’était pas la première fois qu’ils apercevaient des arbres, du ciel bleu, du gazon, qu’ils entendaient l’eau couler et la brise soufflant dans le feuillage ; mais ils n’avaient sans doute jamais admiré tout cela, comme si la nature n’existait pas auparavant, ou qu’elle n’eût commencé à être belle que depuis l’assouvissance de leurs désirs.
À la nuit, ils repartaient. La barque suivait le bord des îles. Ils restaient au fond, tous les deux cachés par l’ombre, sans parler.
Les avirons carrés sonnaient entre les tolets de fer ; et cela marquait dans le silence comme un battement de métronome, tandis qu’à l’arrière la bauce qui traînait ne discontinuait pas son petit clapotement doux dans l’eau.
Une fois, la lune parut ; alors ils ne manquèrent pas à faire des phrases, trouvant l’astre mélancolique et plein de poésie ;
même elle se mit à chanter :
Un soir, t’en souvient-il ? nous voguions, etc.
Sa voix harmonieuse et faible se perdait sur les flots ; et le vent emportait les roulades que Léon écoutait passer, comme des battements d’ailes, autour de lui.
Emma et son amant Léon, aveuglés par leurs premiers jours d'amour... comment peut-on trouver romantique les reflets irisés d'un fleuve pollué, un repas de friture dans un cabaret glauque, parler enfin de nature ainsi en pleine ville? objectivement, c'est ridicule! Mais la soigneuse mise en mots par Flaubert reconstitue à mes yeux parfaitement l'ironie de cet aveuglement, et toute l'histoire ainsi construite sur quelques centaines de pages est au final terriblement convaincante.
Terriblement actuelle aussi, pour moi la gamine de province des années 80: au même moment, j'entends les femmes de la famille chuchoter à demi-mot chez ma grand-mère que la femme de son médecin du bourg doit faire une désintoxication chez les alcooliques anonymes... aurait-elle cherché dans l'alcool cette évasion qu'Emma cherchait dans les bras de ses amants un siècle plus tôt?
Car il s'agit ici d'Emma Bovary pour ceux qui ne l'auraient pas reconnue, très bien rendue dans cet extrait.
Finalement, tout ce roman m'amènera à un début de réalisme sur le genre humain, car je suis sûre de pouvoir reconstituer la galerie de portraits pourtant peu flatteurs de Flaubert en cherchant à peine autour de moi! Mais surtout, ce roman constituera ma première dose de vaccin anti-romantisme idéaliste. L'année suivante, j'achèverai le traitement par la lecture de "Belle du Seigneur", d'Albert Cohen, mais ce sera pour une autre note...
 Pas le temps de bloguer ces jours... derrière moi la pire semaine Kate Reddy depuis longtemps, que je raconterai à l'occasion; mais surtout, devant moi, ma petite pause-évasion tant attendue.
Pas le temps de bloguer ces jours... derrière moi la pire semaine Kate Reddy depuis longtemps, que je raconterai à l'occasion; mais surtout, devant moi, ma petite pause-évasion tant attendue. 










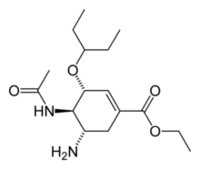
Les commentaires récents